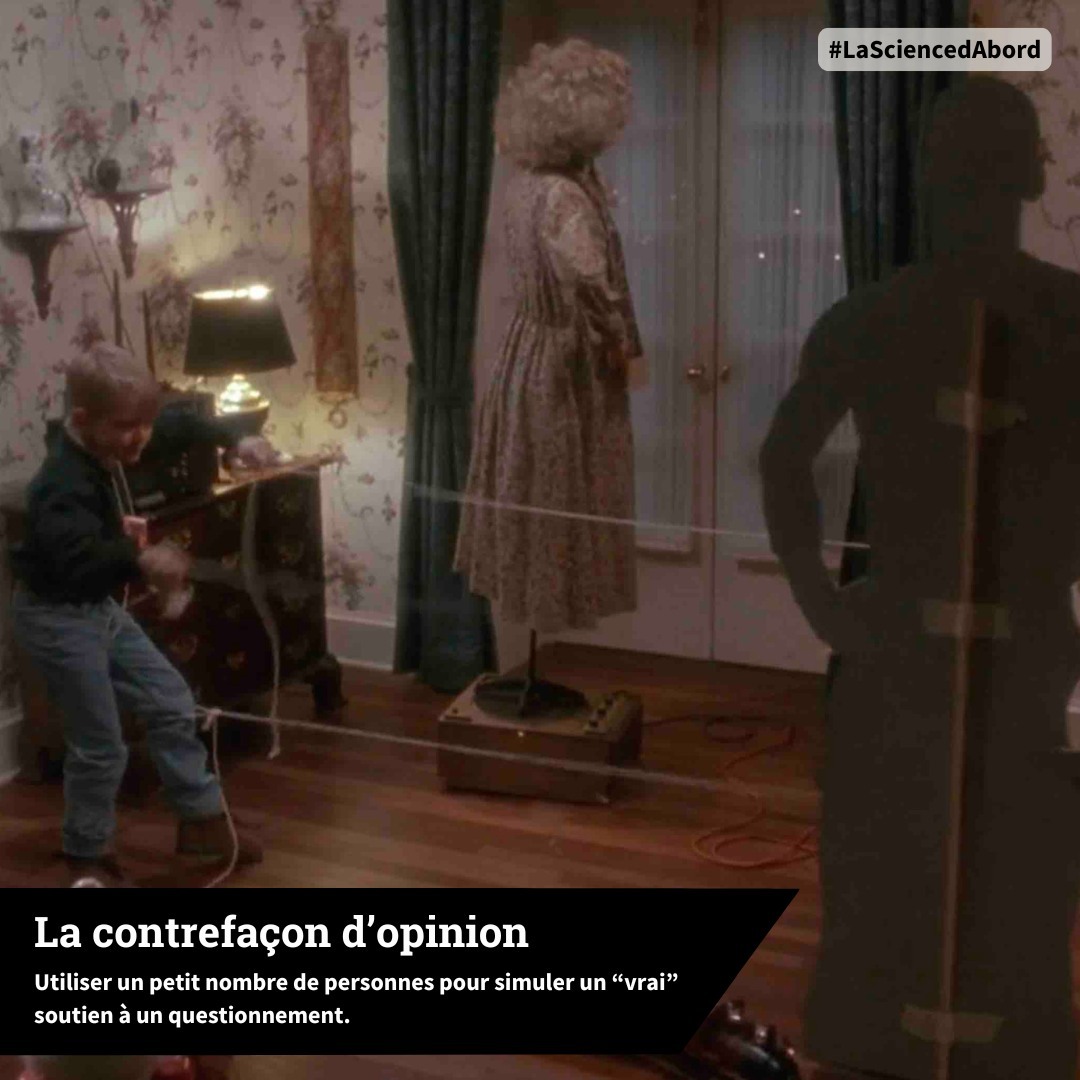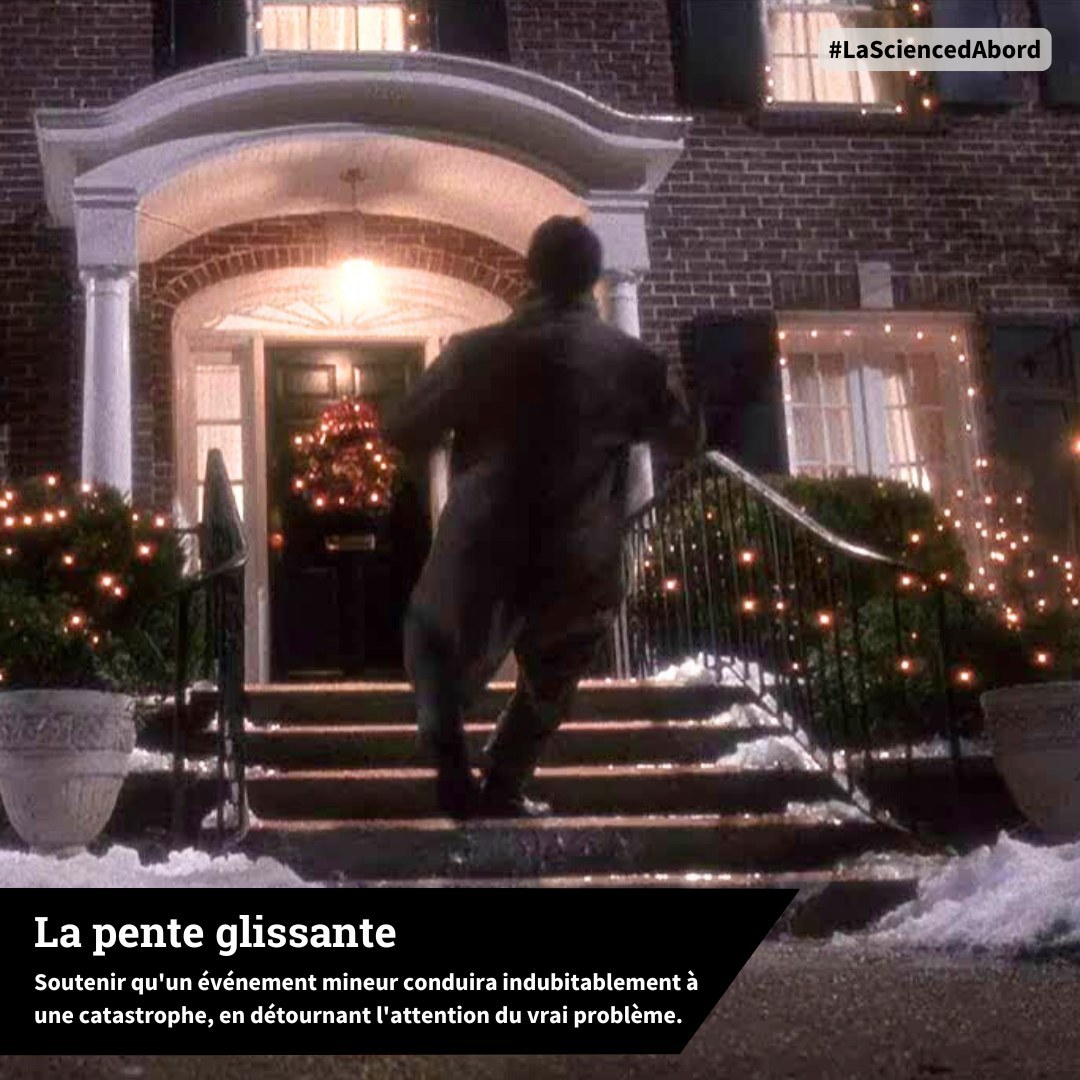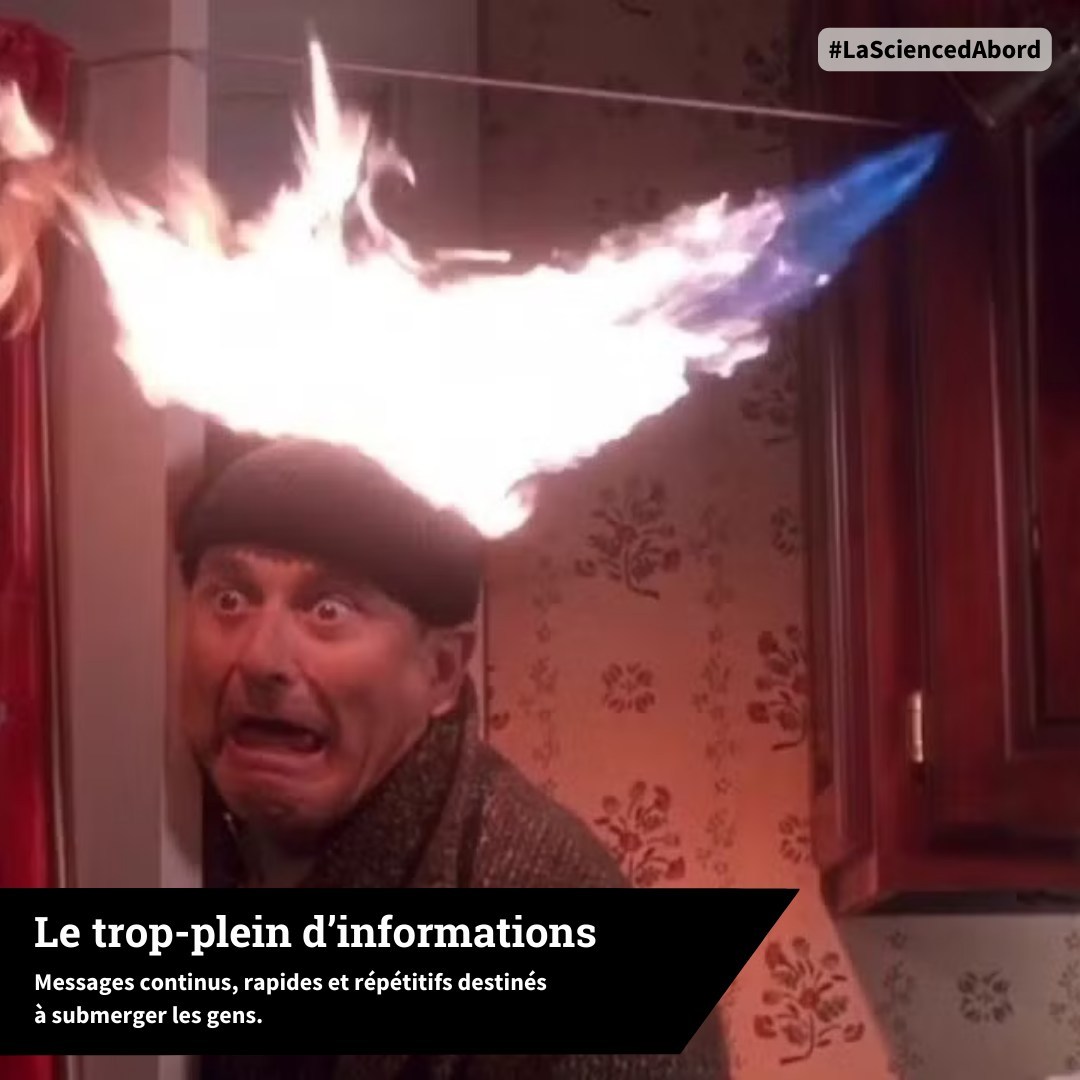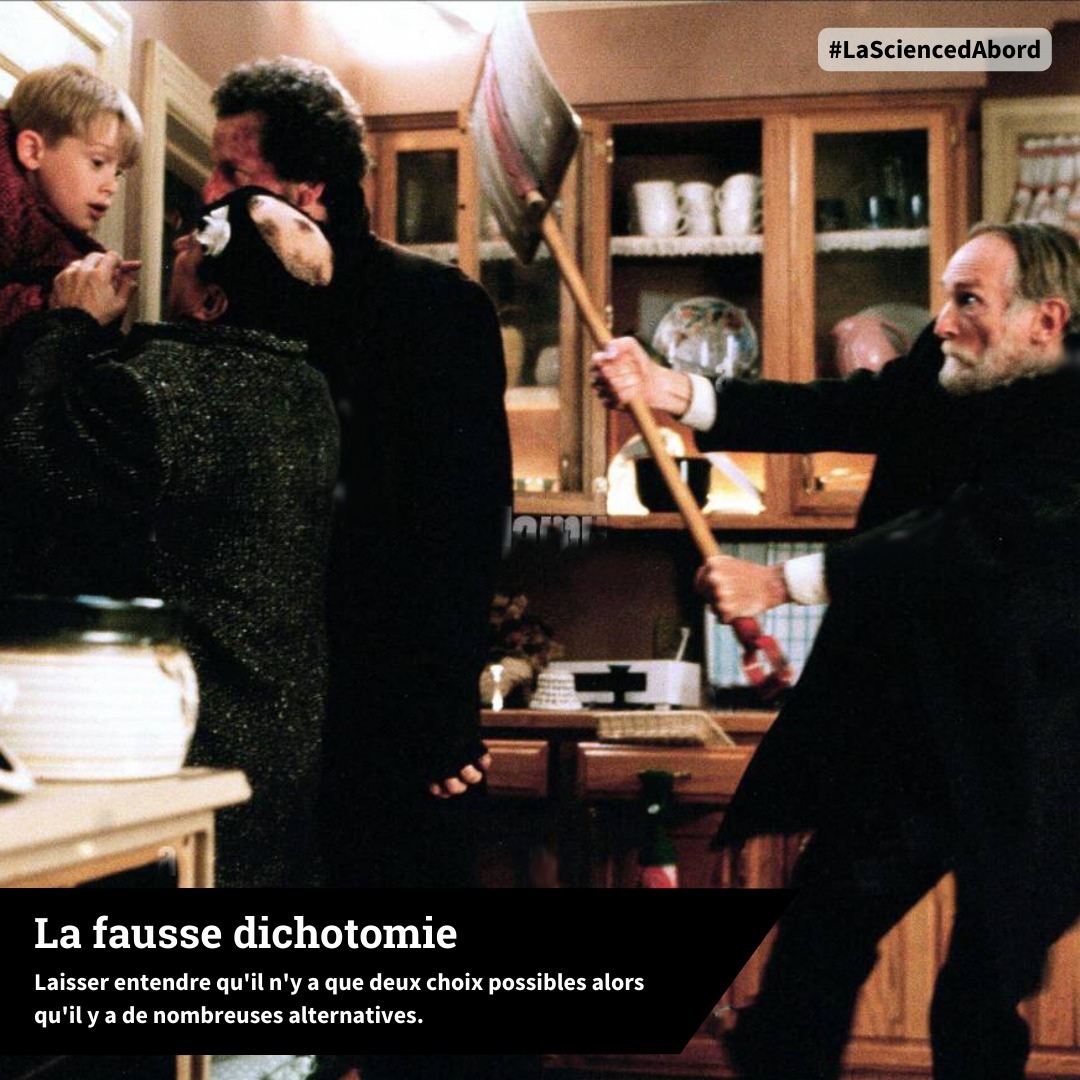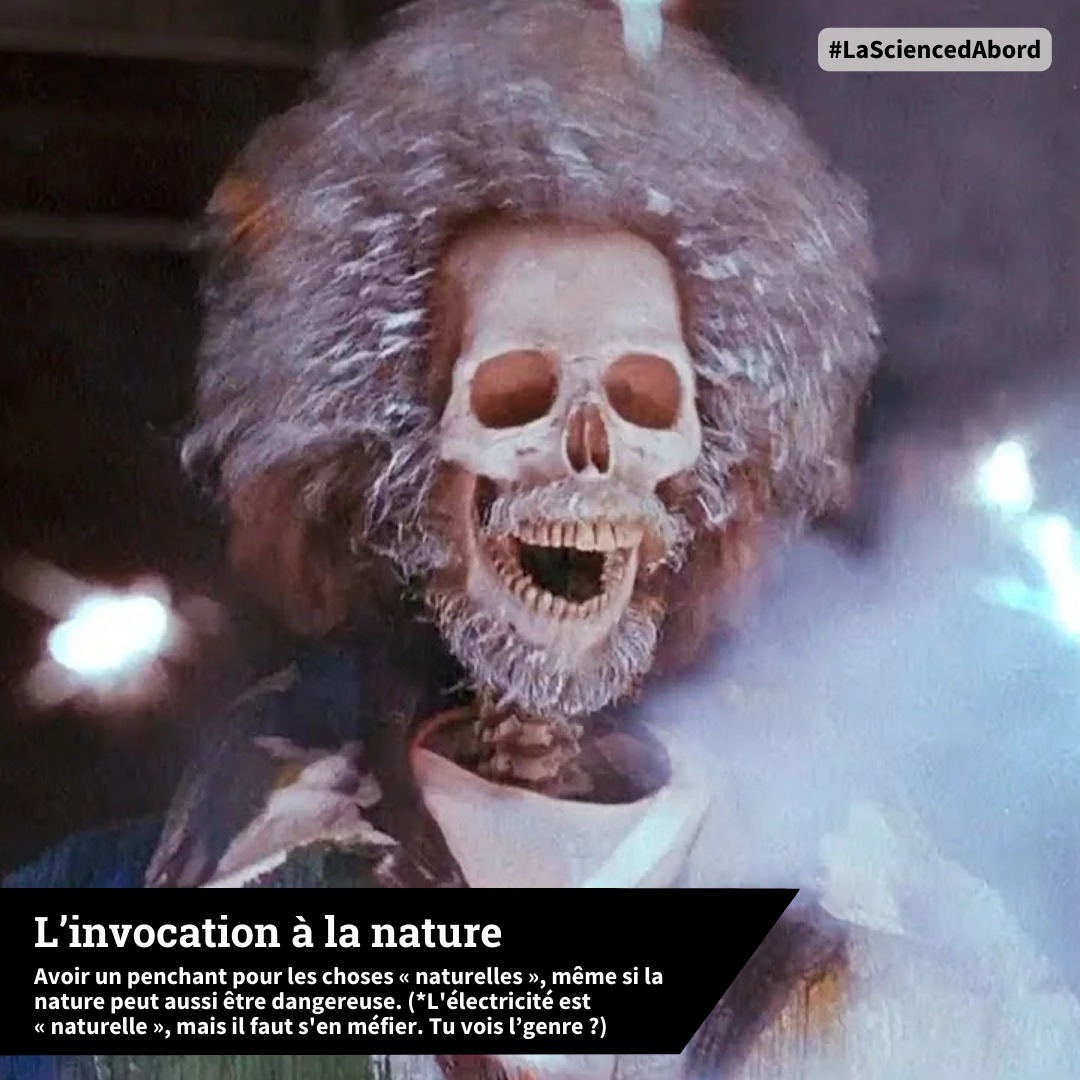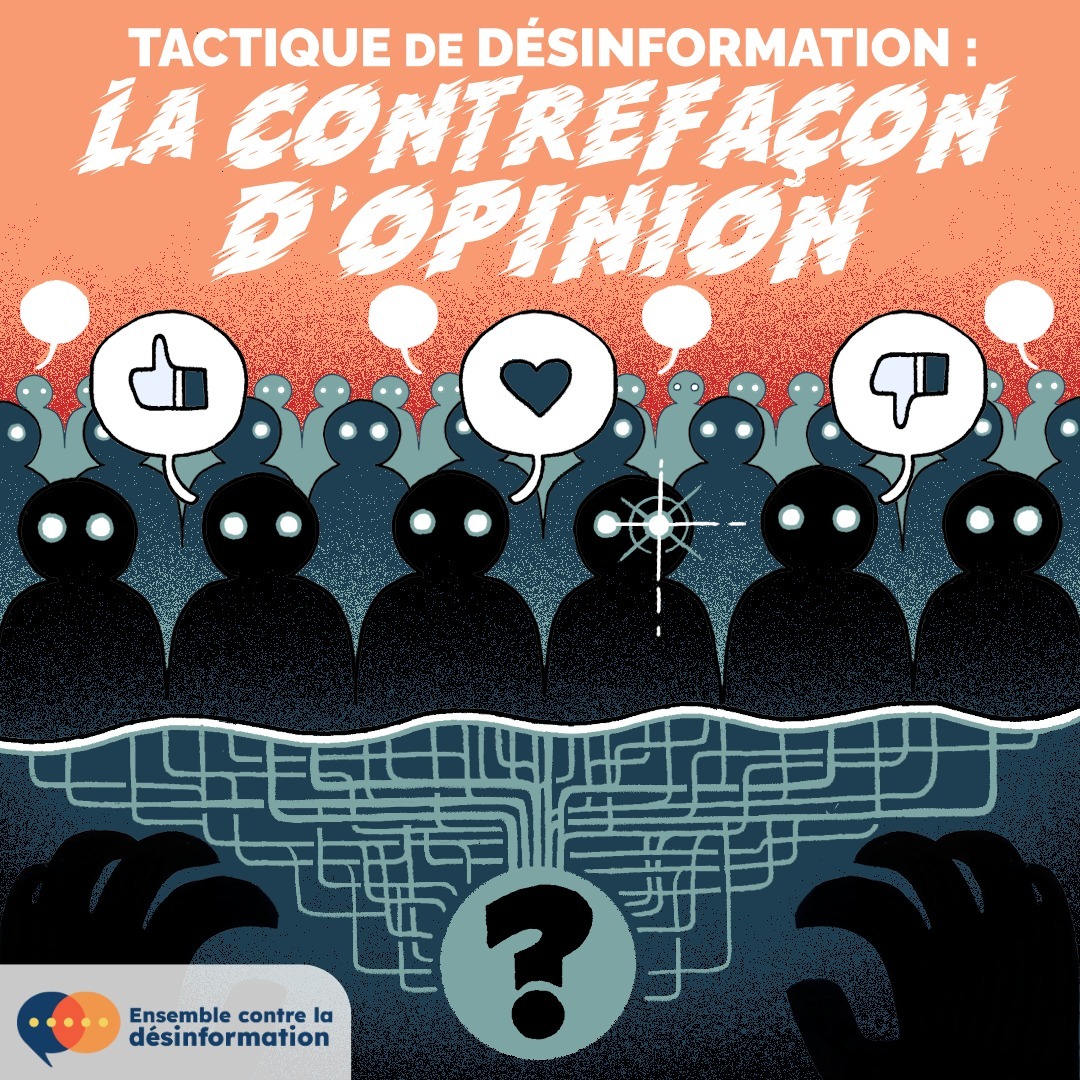La plupart des gens pensent que dormir 8 heures est la norme pour une bonne nuit de sommeil – mais la quantité de sommeil dont nous avons besoin varie en fonction de notre âge.
En fait, plus on vieillit, moins on a besoin de sommeil. Par exemple, alors que les tout-petits ont besoin de 11 à 14h de sommeil (y compris les siestes), les enfants ont besoin de 9 à 12h, les adolescents de 8 à 10h et les adultes de 7 à 9h de sommeil (1-5).
Malheureusement, au Canada, un enfant sur quatre et plus d’un adulte sur quatre ne dorment pas suffisamment. (6,7).
Le sommeil est crucial pour les enfants et les adultes, car il soutient des fonctions vitales pour la croissance, l’apprentissage et la santé en général. Pour les enfants, le sommeil favorise le fonctionnement du cerveau, la mémoire, l’apprentissage, l’attention et la régulation des émotions. S’ils ne dorment pas suffisamment, les enfants peuvent avoir des problèmes d’attention, des sautes d’humeur et des difficultés à l’école. Pour les adultes, le sommeil est essentiel pour la mémoire, la prise de décision, la stabilité émotionnelle et la récupération du corps. Il contribue à réduire le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète, tout en ayant un impact positif sur la santé mentale et le système immunitaire. À chaque étape de la vie, le sommeil joue un rôle clé dans le bien-être général (8-14).
Tu peux améliorer ton hygiène du sommeil en suivant ces conseils simples (7,14,15) :
- Respecte des heures de coucher et de lever régulières
- Crée un environnement de sommeil confortable, frais, sombre et calme.
- Fais de l’exercice régulièrement le matin.
- Évite la caféine, la nicotine et l’alcool dans les heures précédant le coucher.
- Détends ton corps et ton esprit avant de te coucher.
- Si tu t’inquiètes au moment de te coucher, essaie de tenir un journal ou de pratiquer un exercice de respiration profonde ou de méditation.
- Profite de la lumière du jour tous les jours.
- Évite les écrans au moins une heure avant l’heure du coucher.